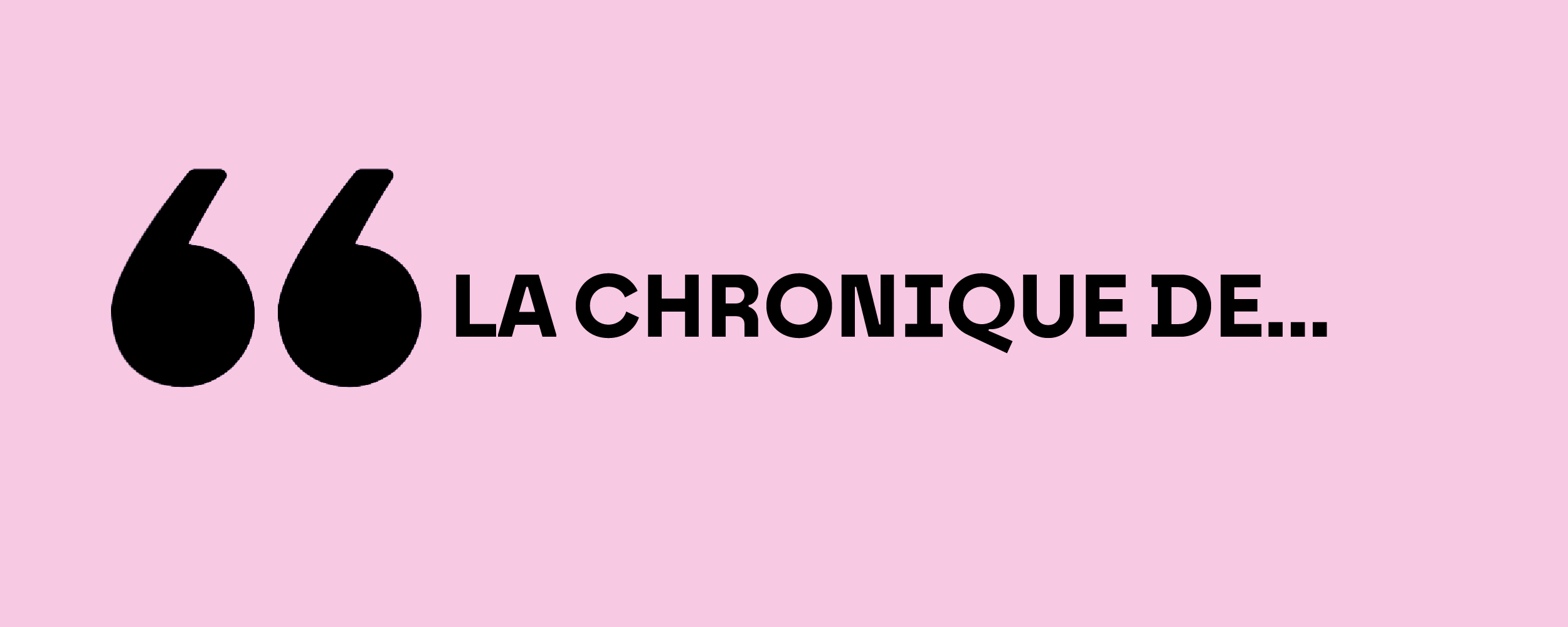
Agnès Dumas
« Avoir souffert d’un cancer dans l’enfance peut engendrer des inégalités sociales. »
Septembre 2025 (n° 407) – Texte : Chloé Dussère
Temps de lecture : 10 minutes
Vivre donne la parole à un expert pour partager un point de vue éclairé sur le cancer. Cette tribune est signée par Agnès Dumas, chargée de recherche à l’Inserm au SESSTIM (Sciences économiques et sociales de la santé et traitement de l’information médicale).

Dans le cadre de mes recherches qui ont débuté il y a près de quinze ans, d’abord au sein de l’Institut Gustave Roussy, puis à l’Inserm, j’ai pu m’entretenir avec de nombreuses personnes ayant été touchées par un cancer durant l’enfance.
Grâce aux progrès de la médecine, elles ont survécu à la maladie mais elles évoquent des séquelles physiques et psychologiques qui ont des répercussions tangibles sur leur vie d’adulte. Dans un pays comme la France, qui bénéficie d’un système de santé que le monde nous envie, des injustices subsistent. Sur le plan professionnel, le fait d’avoir été malade peut fermer des portes. En particulier, l’accès à certains métiers, comme la police ou la gendarmerie, est encore parfois bloqué. Dans le champ de la vie personnelle, les anciennes personnes malades rencontraient jusqu’à peu des difficultés à contracter un emprunt auprès d’une banque.
Depuis 2016, l’introduction du droit à l’oubli dans la loi de modernisation du système de santé permet aux personnes malades de ne plus avoir à déclarer leur passé médical au moment de contracter une assurance emprunteur. C’est une avancée majeure, demandée par les anciennes personnes malades qui ont ainsi pu envisager autrement leurs projets de vie, se doter d’un patrimoine avec la possibilité de le léguer à leurs enfants. Le droit à l’oubli a levé une partie des inégalités qui frappaient ces anciennes personnes malades, mais d’autres inégalités subsistent. Par exemple, les personnes traitées pour une leucémie dans l’enfance peuvent voir leurs capacités cognitives altérées. Cela peut limiter leur parcours scolaire et les freiner dans l’accomplissement de leur vie professionnelle qui, dans un pays comme la France, est largement corrélé au niveau d’études.
Les anciennes personnes malades ont intégré une peur de la discrimination qui peut limiter l’accès à leurs droits. »
Agnès Dumas
On observe aussi des séquelles tardives – fatigue, dépression, problèmes cardiovasculaires, neuropathies… – susceptibles d’entraîner une baisse de la capacité de travail ou des carrières hachées, interrompues par les arrêts
de travail. Certaines personnes, parmi lesquelles celles ayant été traitées pour un ostéosarcome dans l’enfance, peuvent également développer des handicaps avec des problèmes de mobilité, qui les empêchent de travailler et entraînent une baisse de leurs revenus. En France, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) peut les aider mais rares sont les anciennes personnes malades du cancer qui font les démarches pour l’obtenir. Leur handicap étant souvent invisible, elles ne se sentent pas concernées par ce dispositif d’aide et décident parfois de ne pas en faire la demande, par peur d’être discriminées.
Pour réduire les inégalités touchant ces personnes, il est essentiel de soutenir la recherche et le soin sur l’après-cancer. Tout l’enjeu consiste à prévenir les éventuelles séquelles qui surviennent généralement autour de la quarantaine, en particulier le risque cardiovasculaire. Pour cela, il semble important de mobiliser des moyens afin, notamment, de mettre en place et généraliser les consultations de suivi à long terme, qui associent psychologues, oncopédiatres, internistes…
Ces consultations pourraient être en partie réalisées en visioconférence. Cela permettrait de toucher plus facilement la population concernée qui, entre l’enfance et l’âge adulte, peut avoir été amenée à déménager ou ne souhaite pas revenir à l’hôpital où le cancer a été traité. Il est également important de déployer des dispositifs de soins de support, mais aussi des webinaires d’éducation thérapeutique pour informer et prévenir les risques auxquels cette population est exposée. Tout cela dans une logique « d’aller vers » pour atteindre les personnes qui, une fois adultes, sont parfois éloignées des grands centres de soins.
ALLIANCE améliore l’information sur l’après-cancer pédiatrique
Menée en 2017-2018, la recherche ALLIANCE (ALLier Institutions Adultes pareNts Cliniciens et chErcheurs pour améliorer l’accès à l’information après un cancer pédiatrique) est le fruit d’une collaboration entre des chercheurs de l’Inserm, dont Agnès Dumas, et des représentants de l’association Les Aguerris, qui rassemble d’anciennes personnes malades touchées par un cancer dans l’enfance. Après une analyse des besoins de ces personnes en matière d’information sur l’après-cancer et de suivi, cette recherche « par les pairs » a notamment permis de mettre au point une carte des consultations de suivi à long terme. Cet outil, régulièrement mis à jour, est accessible sur le site de la Société française des cancers de l’enfant (SFCE).
