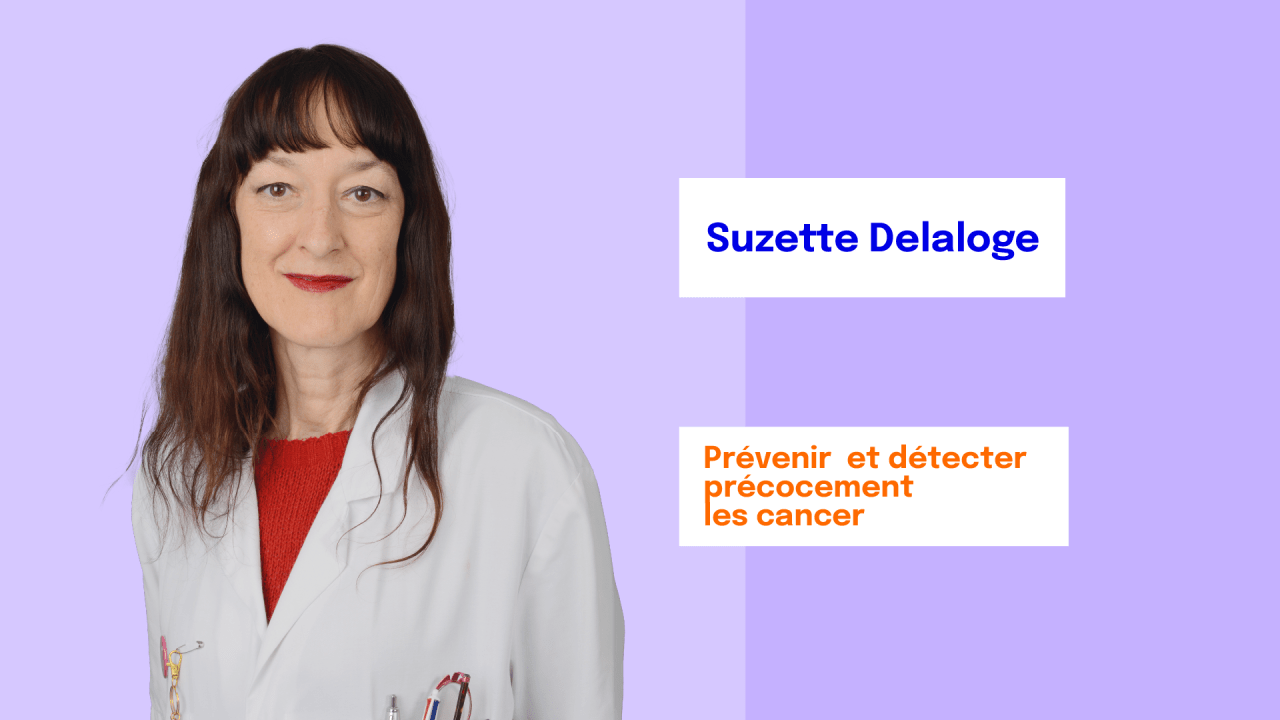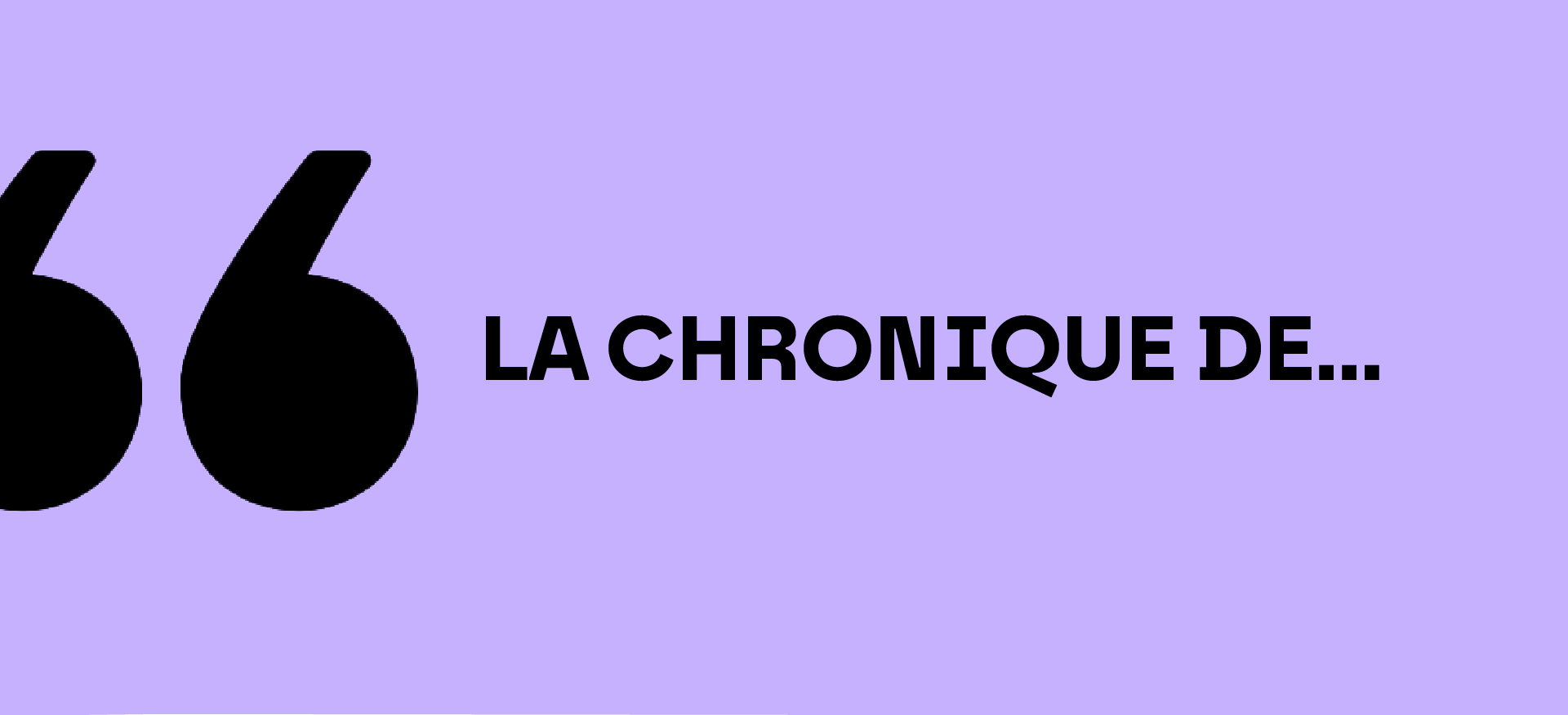
Suzette Delaloge
« La France a besoin de forces dédiées à la prévention. »
Juin 2025 (n° 406) – Texte : Chloé Dussère
Temps de lecture : 10 minutes
Vivre donne la parole à un expert pour partager un point de vue éclairé sur le cancer. Cette tribune est signée par Suzette Delaloge, oncologue et chercheuse à Gustave Roussy, spécialiste du cancer du sein et de la prévention du cancer.
Tant qu’on n’est pas malade, la santé est perçue comme un moyen, non comme une fin. On ne pense pas à sa santé quand on est en bonne santé. C’est pourquoi il est extrêmement difficile d’œuvrer pour la prévention, avant que la maladie n’arrive. Or, en changeant de comportement vis-à-vis du tabac, de l’alcool ou encore du surpoids, il est possible de diminuer son risque de cancer
de 25 à 30 %. Il y a donc une réelle nécessité à aider les gens à améliorer leur santé. En la matière, la France s’est engagée sur plusieurs sujets comme le tabac, et sa consommation semble globalement diminuer même si une nouvelle hausse a été enregistrée après la forte baisse liée à la crise du Covid. Concernant le papillomavirus, notamment à l’origine du cancer du col de l’utérus, une importante campagne de vaccination a pu être mise en œuvre. Résultat : la vaccination progresse chez les filles, mais pas encore assez significativement chez les garçons.
Au sujet des facteurs de risque que constituent l’alcool et le surpoids, on assiste à une emprise très forte des logiques de marché et des arguments marketing qui entrent en contradiction avec les injonctions individuelles à manger sainement et à limiter sa consommation d’alcool. Cela décrédibilise globalement les autorités de santé et leur capacité à contrer les lobbies industriels. Il y a également les risques liés à l’environnement – pesticides, perturbateurs endocriniens… –, qu’on ne peut que subir car nous manquons de données, de règles et de lois pour limiter ces expositions toxiques.

Il y a une nécessité à “industrialiser” la prévention et à en faire un sujet désirable. »
Suzette Delaloge, oncologue et chercheuse à Gustave Roussy, spécialiste du cancer du sein et de la prévention du cancer
Il existe donc, à mes yeux, un réel enjeu à remettre la valeur santé au cœur de toute notre société, de nos organisations, afin qu’elle soit une préoccupation partagée par l’ensemble de la population. Les médecins généralistes pourraient jouer un rôle clé dans ce projet mais ils sont tellement surchargés et si peu nombreux qu’ils n’ont que peu de temps pour contribuer à la prévention. Les acteurs non professionnels de santé ont un rôle majeur à jouer, parmi lesquels des associations comme la Ligue contre le cancer qui œuvre depuis de nombreuses années comme grand acteur de santé publique, ou encore des relais plus communautaires. Des corps intermédiaires de santé pourraient également être mobilisés, tels que les infirmières et les pharmaciens.
Interception : la prévention personnalisée du cancer
Né en 2021 à l’Institut Gustave Roussy et dirigé par Suzette Delaloge, le programme Interception vise à prévenir et dépister le cancer chez les personnes présentant un risque augmenté, lesquelles représenteraient au moins 40 % des personnes qui vont développer un cancer. Concrètement, le médecin traitant ou un autre professionnel de santé identifie une situation de risque élevé de certains cancers chez un patient en fonction de certains facteurs (hérédité, tabac, alcool…). Ce dernier peut ensuite bénéficier d’une « journée Interception » dans un des centres de soins participants où il bénéficie de consultations, examens et ateliers. Il en ressort avec un programme et un suivi personnalisé pour limiter son risque et/ou maximiser les chances d’un dépistage précoce.
Un canal encore trop peu exploité, celui de la pair-aidance, me semble également très intéressant car le partage d’une parole individuelle, d’un vécu, peut avoir un fort impact. On observe, par exemple, que les femmes vont plus facilement se rendre à leur mammographie de dépistage si une femme de leur entourage a eu un cancer du sein. À l’échelle de notre pays, il serait intéressant de pouvoir bénéficier d’études sur les risques et les bénéfices de certaines options, comme celle d’un prix plancher de l’alcool, une initiative qui divise. La transparence sur les enjeux et les raisons des décisions prises serait également souhaitable, en parallèle d’un travail visant à augmenter le niveau d’éducation de chacun sur les sujets liés à la santé. De même, une meilleure connaissance de l’état des lieux de l’épidémiologie des cancers avec la mise en place d’un registre national nous permettrait d’avancer de manière plus éclairée. Enfin, s’engager réellement dans la prévention implique de créer des forces de prévention avec des professionnels dédiés exerçant des missions transversales qui dépassent le seul cadre du cancer.
Il y a une nécessité à « industrialiser » la prévention et à en faire un sujet désirable. C’est pourquoi nous ne pouvons que nous réjouir que de nouveaux acteurs s’y intéressent, comme la Ligue le fait depuis longtemps, avec la volonté de faire évoluer les modes de pensée.

A lire
Prédire et prévenir le cancer,
de Suzette Delaloge et Lionel Pourtau,
CNRS éd., 2017.